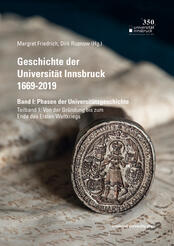Dear colleagues,
Please find below a call for contributions for an international conference to be held in Moscow on 2020 June 29th-30th on Women and science and technology since the end of the xixth century.
This conference is being held in memory of Larissa Zakharova (1977-2019).
Best regards,
For the organizers
Governing Science and Technology,
Governing through Science and Technology:
What was at Stake for Women?
(From the late 19th to the early 21st century)
The
history of women in science and technology has witnessed a real renewal
of historiography these past few years. Recent studies have notably
shown that their presence in these fields, despite growing in strength
from the late nineteenth century onwards, was far from being the result
of a continuous and inevitable process: their accession has been
difficult and reversible, and important forms of discrimination have
been maintained to this day.
This
conference aims to contribute to this historiographical trend, but is
perhaps less interested in women in science and technology as actresses
of situated practices rather than in focusing upon a dimension that is
nowadays increasingly under scrutiny: the place and role of women in the
government of science and technology, and in government through science and technology.
This
conference thus seeks to understand and historicize the various and
cumulative mechanisms that determined—that is to say blocked, delayed or
promoted—the careers of female scientists and engineers and their
access to high levels of responsibility, beginning in the late
nineteenth century when women began to enter the fields of science and
technology thanks to the growing education of girls. Paradoxically,
although these fields have been crucibles for the ideology of progress
and emancipation, women in them have always been subordinates: even
today, only a few hold positions of authority. Yet seeking to answer the
question of women’s access to the authorities that govern science and
technology requires the adoption of a wide perspective that, while
avoiding the shoal of the mere collection of biographies, analyses how
women although excluded nevertheless managed to influence the government
of science and technology—be it through their work or by accessing
peripheral roles. In turn, this requires an analysis of the policies
that various actors introduced in order to promote women in these fields
and overcome the forms of resistance they encountered, and notably the
role that science and technology played as resources for policies that
actively sought to favour women.
This
conference therefore aims to study a dual process in which women are
both subjects and objects of the government of science and technology.
*
All
the fields of science and technology can be considered, from the oldest
to those that became established during the twentieth century and in
which the place and role of women may have changed—especially the
aerospace, nuclear and computer industries. Similarly, different
cultural areas and/or political regimes (liberal and authoritarian) may
be studied. The example of Russia, where after the October Revolution
the Bolsheviks claimed to be emancipating women while arguing that their
project for social transformation was based upon scientific and
technical knowledge, clearly shows the interest in shifting the focus in
order to compare different cultural areas and/or political regimes;
this comparison should in turn enable us to question national, cultural
and/or political divides.
Various lines of enquiry are possible.
The
first of these focuses upon women having reached positions of
authority: their scientific or technical education and training, their
career, and the factors that enabled them to access high rank in
education, research or industry. The case of biochemist Marjory
Stephenson in Great Britain, the first woman to join the Royal Society
in 1945 despite legal barriers to accessing scientific societies and
universities having been removed in 1919, shows the Royal Society’s
resistance to lifting discriminatory statutes, as well as the role of
reactions in the press criticizing their removal in 1943. The enquiry
does not merely focus upon the absence or presence of women, but also
considers the work of scientific and technical institutions, including
the nomination of their members: the task is to characterize the ‘glass
ceiling’ that female scientists and engineers encountered and to
identify the historical and concrete forms it took. Work will also seek
to understand the ways in which women sought to go around the
difficulties that some put in their way in the legitimate spaces of
production and tuition of science and technology by involving themselves
in others, such as scientific associations and societies.
A
second line of enquiry could be to ask if female scientists and
engineers, having reached a position of authority, carried out specific
policies. However, this question of a typically female government of
science and technology is a tricky one: the matter was already brought
up in the historiography with regard to the production of knowledge, and
has shown its limits. That said, the example of chemist Ida Maclean—who
after having been made assistant lecturer at Manchester University’s
Department of Chemistry in 1906, became in 1920 the first woman to be
admitted to the London Chemical Society, where she pursued her
long-standing commitment to women at university—invites us to focus upon
at least two phenomena. The first relates to measures taken within
scientific and technical institutions to improve the situation of women.
The second concerns problems privileged by women having attained
positions of responsibility: the aim is to see if they dealt with
matters that men had neglected or ignored, and what measures they took
to resolve or at least address these problems.
A
third line of enquiry aims to analyse how different protagonists
resorted to science and technology to reduce gender inequality in
society. The historiography has underlined the extent to which
knowledge—particularly but not exclusively in the field of
biology—reproduced gender-based prejudice and naturalised inequalities
between men and women. Always with the goal of probing the neutrality of
science, the question here, however, relates rather to the way in which
knowledge sometimes contradicted gender-based stereotypes and norms, in
order to understand how knowledge was used to carry out policies
seeking to improve women’s statutory recognition and/or pay. The most
famous example is without doubt that of the United States where, thanks
to the positive discrimination introduced in 1967 for female students
and teachers, universities became centres of action and thought for the
feminist movements. But the State has not been the only actor to support
women in society: foundations and large companies also have and
continue to do so. By studying these initiatives, the goal is also to
shed light upon connections between scientific knowledge, statutory
recognition and economic redistribution. When these initiatives
coexisted with emancipatory measures aimed at other social groups, the
ways in which they may have intersected will need to be analysed.
A
last line of enquiry concerns the ways in which the success of women in
science and technology is narrated. The goal is to study not only how
commentators describe and explain such success, but also how female
scientists and engineers having attained senior positions did so
themselves. For it appears that the narration by men and women of these
paths to success often resorts to clearly sexual motifs, and these
narratives influence gender-based prejudices and stereotypes by
consolidating or on the contrary undermining them. Portraits of the
mathematician Sofia Kovalevskaya, for example, have sometimes emphasized
her analytical abilities or underlined how lacking she was in feminine
qualities. The study of such narratives could therefore help us to
understand the weight of representations that bears down upon women’s
career choices.
----
This
conference is being held in memory of Larissa Zakharova (1977-2019), a
specialist of the Soviet Union who devoted much of her work to the
history of technology (https://www.cercec.fr/membre/larissa-dufaud-zakharova/). Her last work, to be published by the ‘Éditions de l’EHESS’, is entitled De Moscou aux confins les plus profonds. Communications, pouvoir et société en Union soviétique (‘From Moscow to the Remotest Corners: Communication, Power and Society in the Soviet Union’).
The conference, where English will be the language of communication, will be held on 2020 June 29th-30th in Moscow. Its aims include publishing a book, and participants are therefore invited to submit unpublished work.
Papers must be sent at least two weeks before the conference, and articles for submission by the 1st of November 2020.
As far as possible, the organizers will cover the cost of travel and accommodation.
----
Organizers
Alain Blum (CERCEC / EHESS / INED)
Patrice Bret (CAK / CNRS)
Valérie Burgos Blondelle (Comité pour l’histoire du CNRS)
Françoise Daucé (CERCEC / EHESS / IUF)
Grégory Dufaud (Sciences Po Lyon / CEFR de Moscou / LARHRA)
Liliane Hilaire-Pérez (Université Paris-Diderot / EHESS / IUF)
Isabelle Lémonon Waxin (CAK / Cermes3)
----------------------------
Chères et chers collègues,
Veuillez trouver ci-dessous l’appel à contributions pour un colloque international qui se tiendra à Moscou les 29 et 30 juin 2020 sur les femmes et les sciences et les techniques depuis la fin du xixe siècle.
Ce colloque est organisé à la mémoire de Larissa Zakharova (1977-2019).
Bien cordialement,
Pour les organisateurs
Gouverner les sciences et les techniques,
gouverner par les sciences et les techniques :
quels enjeux pour les femmes ?
(fin xixe siècle – début xxie siècle)
L’histoire des femmes dans les sciences et les techniques a fait l’objet d’un véritable renouveau historiographique ces dernières années. Les travaux réalisés ont notamment montré que leur présence dans ces domaines, si elle s’était renforcée à partir de la fin du xixe siècle, était loin d’avoir été le résultat d’un processus continu et inéluctable : leur accession a été difficile et réversible, avec le maintien d’importantes discriminations jusqu’à nos jours.
Ce colloque souhaite participer à ce mouvement historiographique en s’intéressant peut-être moins aux femmes dans les sciences et les techniques en tant qu’actrices de pratiques situées qu’en se focalisant sur une dimension qui fait l’objet d’une préoccupation croissante de nos jours : à savoir la place et le rôle des femmes dans le gouvernement des sciences et des techniques, et dans le gouvernement par les sciences et les techniques.
Ce colloque veut ainsi comprendre et historiciser les mécanismes variés et cumulatifs qui ont déterminé — bloqué, freiné, voire favorisé — la carrière des scientifiques et des ingénieures et leur accession à de hautes responsabilités, et ceci depuis la fin xixe siècle quand elles ont commencé à investir les sphères scientifiques et techniques du fait de l’essor de la scolarisation des filles. Paradoxalement, si ces domaines ont été des creusets de l’idéologie du progrès et de l’émancipation, les femmes y sont restées en position subordonnée : aujourd’hui encore, elles ne sont pas si nombreuses à y occuper des postes de direction et d’autorité. Mais se poser la question de leur accès aux instances de gouvernement des sciences et des techniques nécessite de se donner une perspective large qui, tout en évitant l’écueil de la collection de biographies, analyse par quels moyens les femmes, faute d’accès à ces instances, sont tout de même parvenues à peser sur le gouvernement des sciences et des techniques — que ce soit par leurs travaux ou en investissant des lieux périphériques. Cela suppose en retour de s’interroger sur les politiques déployées par des acteurs variés pour promouvoir les femmes dans ces domaines et vaincre les résistances rencontrées : il convient d’analyser le rôle joué par les sciences et les techniques en tant que ressources pour des politiques actives à l’endroit des femmes.
Ce colloque entend donc étudier un double mouvement, avec des femmes à la fois sujets et objets du gouvernement des sciences et des techniques.
*
Tous les domaines scientifiques et techniques peuvent être abordés, des mieux établis à ceux qui l’ont progressivement été au cours du xxe siècle et où la place des femmes a pu changer, l’aérospatial, le nucléaire et l’informatique en particulier. De même, toutes les aires culturelles et/ou tous les régimes politiques (libéraux et autoritaires) sont susceptibles d’être étudiés. L’exemple de la Russie où, au lendemain de la révolution d’Octobre, les bolcheviks affirmaient vouloir émanciper les femmes, tandis qu’ils prétendaient fonder leur projet de transformation sociale sur les savoirs scientifiques et techniques, signale tout l’intérêt qu’il peut y avoir à décentrer le regard et à comparer les aires culturelles et/ou les régimes politique — la comparaison devrait en retour nous autoriser à questionner les clivages nationaux, culturels et/ou politiques.
Différentes pistes de travail sont envisageables.
La première porte sur les femmes ayant accédé à des postes de direction : la formation scientifique ou technique reçue, leur carrière, et ce qui leur a permis d’accéder à des fonctions élevées dans l’éducation, la recherche ou l’industrie. Ainsi, en Grande-Bretagne, le cas de la biochimiste Marjory Stephenson, première femme à accéder à la Royal Society en 1945, alors que les barrières légales de l’accès aux sociétés savantes et à l’université avaient été supprimées en 1919, montre la résistance de la Royal Society à faire évoluer des statuts discriminatoires, ainsi que le rôle des critiques adressées dans la presse dans leur levée en 1943. Le questionnement ne porte pas que sur l’absence ou la présence des femmes, il concerne aussi le fonctionnement des institutions scientifiques et techniques, y compris dans les nominations : c’est s’attacher à caractériser le « plafond de verre » auquel les scientifiques et ingénieures se sont heurtées et à identifier les formes historiques et concrètes qu’il a pris. L’interrogation concerne enfin la manière dont les femmes ont cherché à contourner les difficultés qu’on leur a opposées dans les lieux légitimes de production et d’enseignement des sciences et des techniques en investissant d’autres espaces, telles les associations et les sociétés savantes.
Une deuxième piste peut être de se demander si les scientifiques et les ingénieures, une fois à des postes de direction, ont mis en œuvre des politiques spécifiques. Cette question d’un gouvernement typiquement féminin des sciences et des techniques est épineuse. Déjà soulevée dans l’historiographie à propos de la production des savoirs, elle a montré ses limites. Cependant, l’exemple de la chimiste Ida Maclean qui, après avoir été nommée assistant lecturer au département de chimie de l’université de Manchester en 1906, est devenue en 1920 la première femme à accéder à la London Chemical Society où elle a poursuivi son engagement de longue date en faveur des femmes à l’université, invite à porter l’attention sur au moins deux phénomènes. Le premier a trait aux mesures prises au sein des institutions scientifiques et techniques pour y améliorer la situation des femmes. Le second concerne les problèmes mis en avant par les femmes ayant accédé à des fonctions élevées : il s’agit de voir si elles ont soulevé des problèmes négligés ou non vus par les hommes et quelles actions elles ont lancées sinon pour les résoudre, du moins pour les traiter.
Une troisième piste vise à analyser comment différents protagonistes ont eu recours aux sciences et aux techniques pour remédier aux inégalités de genre dans la société. L’historiographie a souligné combien les savoirs — en particulier ceux issus de la biologie, mais pas seulement — avaient reproduit les préjugés de genre et naturalisé les inégalités entre les hommes et les femmes. Toujours dans la perspective de sonder la neutralité des sciences, l’interrogation porte toutefois ici plutôt sur la manière dont les savoirs ont pu contredire les stéréotypes et les normes de genre, et ceci en vue de comprendre comment on les a utilisés pour mettre en œuvre des politiques en faveur d’une meilleure reconnaissance statutaire et/ou salariale des femmes. Le cas certainement le mieux connu est celui des États-Unis où, avec la discrimination positive instaurée en 1967 pour les étudiantes comme pour les enseignantes, les universités sont devenues des lieux d’action et de réflexion pour les mouvements féministes. Mais l’État n’a pas été le seul acteur à œuvrer pour les femmes dans la société : des fondations et des grandes entreprises l’ont fait et continuent de le faire. À travers l’étude de ces initiatives, il doit aussi s’agir d’éclairer comment s’est construite l’articulation entre savoirs scientifiques, reconnaissance statutaire et redistribution économique. Lorsque ces initiatives ont coexisté avec des mesures d’émancipation visant d’autres groupes sociaux, il faudra tâcher d’analyser comment elles ont pu s’entrecroiser.
Une dernière piste a trait à la mise en récit de la réussite des femmes dans les sciences et les techniques. Le but est d’étudier non seulement comment les commentateurs la décrivent et l’expliquent, mais aussi comment des scientifiques et des ingénieures qui ont atteint des positions élevées le font elles-mêmes. Car il apparaît que la mise en récit de ces trajectoires par les hommes et les femmes mobilise souvent des motifs clairement sexués. Or ces discours ne sont pas sans incidence sur les préjugés et les stéréotypes de genre, que ce soit dans le sens de leur consolidation ou au contraire de leur déconstruction. Par exemple, les portraits de la mathématicienne Sofia Kovalevskaïa ont tantôt insisté sur ses qualités d’analyse, tantôt souligné combien elle était dépourvue de qualités féminines. L’examen de ces récits de trajectoire peut donc aider à appréhender le poids des représentations sur les choix de carrière des femmes.
----
Ce colloque est organisé à la mémoire de Larissa Zakharova (1977-2019) qui, spécialiste de l’Union soviétique, a consacré une partie de ses travaux à l’histoire des techniques (
https://www.cercec.fr/membre/larissa-dufaud-zakharova/). Portant sur les communications, son dernier ouvrage est intitulé :
De Moscou aux confins les plus profonds. Communications, pouvoir et société en Union soviétique (à paraître aux Éditions de l’EHESS).
Le colloque, où les interventions seront en anglais, se tiendra les 29 et 30 juin 2020 à Moscou. Il entend donner lieu à un livre. Sont donc sollicitées des propositions inédites : les « papiers » devront être envoyés au moins deux semaines avant le colloque et les textes, remis au 1er novembre 2020 au plus tard.
Dans la mesure du possible, les organisateurs prendront en charge les frais de déplacement et de logement.
----
Organisateurs
Alain Blum (CERCEC / EHESS / INED)
Patrice Bret (CAK / CNRS)
Valérie Burgos Blondelle (Comité pour l’histoire du CNRS)
Françoise Daucé (CERCEC / EHESS / IUF)
Grégory Dufaud (Sciences Po Lyon / CEFR de Moscou / LARHRA)
Liliane Hilaire-Pérez (Université Paris-Diderot / EHESS / IUF)
Isabelle Lémonon Waxin (CAK / Cermes3)